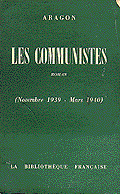Si
le principe et la difficulté du double-jeu relèvent
avant tout des profondes divergences entre la politique et le littéraire
qui possèdent chacun leurs rythmes et leurs enjeux propres,
il faut cependant convenir que la Guerre Froide est pour beaucoup
dans l'échec de ce jeu trouble où Aragon a déjà
donné la mesure de son art. Il n'y aura pas de seconde Drôle
de guerre, comme une respiration permettant de trouver un moyen
de sortir de la pression du Pacte germano-soviétique. Quand
la Guerre Froide éclate en 1947, l'écrivain est en
pleine lumière, pris dans une actualité sur laquelle
il a du mal à imprimer sa marque originale. Parler d'une
« heure du choix » n'aurait guère de sens tant
le choix va de soi et qu'il est déjà fait.
Pour Aragon, la poésie nationale représente, on l'a
vu, la volonté de s'inscrire dans la continuité de
la guerre. L'autre continuité possible, celle des romans
du « Monde réel », est déjà condamnée
quand éclatent au grand jour les tensions politiques. Aurélien,
le roman écrit pendant la guerre, est publié en 1945
dans une indifférence générale. Tout comme
les Voyageurs de l'impériale, achevés en 1939, mais
qui ont dû attendre 1947 pour être publiés dans
leur version intégrale. Ce n'est que bien plus tard qu'Aurélien
sera tiré de l'oubli initial pour devenir le monument littéraire
qu'on célèbre aujourd'hui. Le roman, dont il est convenu
de dire qu'il est celui où l'auteur a versé le plus
de lui-même, à la faveur sans doute des circonstances
de la guerre et du choc de la disparition de sa mère en 1942,
sera en effet reçu bien plus tard comme un roman d'amour
- ce qu'il est, bien sûr - et à la faveur d'un oubli
de son contenu positif, de sa « morale » politique -
qu'il contient aussi. Car Aurélien est le roman d'un double
échec, amoureux et politique, dès lors que sa figure
centrale perd à la fois Bérénice et l'occasion
d'une rupture salutaire : contrairement à l'Armand Barbentane
des Beaux Quartiers, Aurélien est celui qui accepte d'endosser
les habits du bourgeois et d'entrer dans l'usine que sa classe le
destine à diriger. On ne peut s'empêcher de voir dans
cette lecture sélective et tardive qui ne retient que l'amour
d'Aurélien et de Bérénice, une forme de contrebande
inversée, en tous points opposée à celle des
poèmes de guerre où la chanson d'Elsa permettait de
faire passer le « message » politique...
Dans l'immédiat, le « Monde
réel » est dans l'impasse, à contretemps de
ce qu'attendent ses éventuels lecteurs. À ceux qui,
dans le champ littéraire, reprochent au poète ses
vers « de circonstances », s'opposent, dans le parti,
ceux qui s'étonnent de la futilité du romancier. Les
Communistes formeront sa réponse aux derniers, montrant aussi
par là ceux qu'il choisit de contenter, choix redoublé
d'ailleurs par celui de l'éditeur, la Bibliothèque
Française et non pas Gallimard.
La fin des années 40 et
le début des années 50 sont les plus politiques d'Aragon.
Disant cela, il faut bien faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'un
investissement politique particulièrement intense, ou d'un
rôle politique spécialement important. La fin des années
50 et le début des années 60 seront, de ce point de
vue, au moins autant politiques que celles-là. Et peut-être
plus encore. Si Aragon est politique à cette époque,
c'est surtout parce que ses écrits littéraires le
sont plus qu'à aucune autre époque. Affichés
et lus comme tels.
Il faut encore revenir sur l'idée qu'il n'est pas un compagnon
de route, un intellectuel qui a choisi de « s'engager »
auprès de la cause communiste. Il est communiste de l'intérieur,
d'une manière organique. Et s'il n'est pas que cela, le reste
se trouve réduit à la portion congrue pendant les
années de Guerre Froide.
La reprise en main du quotidien Ce Soir illustre la pression des
événements et la logique de son rôle en période
de tensions politiques. Ayant retrouvé le journal en septembre
1944, il s'était empressé de se débarrasser
de cette charge, trop peu littéraire sans doute à
son goût. Mais à la mort de Jean-Richard Bloch en 1947,
l'impératif de servir s'impose à nouveau et il faut
accéder à la demande du parti qui lui demande de reprendre
son poste. Aragon entre donc en Guerre Froide sur un poste politiquement
exposé et sensible. Bien sûr, il contribue largement
à la défense de la paix, bannière sous laquelle
le parti communiste rassemble les intellectuels. Aragon donne ainsi
sa Naissance de la paix par René Descartes en 1949, prononce
« la Lumière et la paix » au congrès international
des intellectuels de 1951, et encore un grand discours au congrès
mondial de la paix à Vienne en 1952. Mais ce sont d'autres
que lui qui organisent le combat des compagnons de route, et c'est
Elsa Triolet qui s'investit surtout dans l'animation du Comité
National des Écrivains. Lui passe l'essentiel de son temps
à Ce Soir.
Élu membre suppléant du comité central à
l'issue du congrès de 1950, il occupe désormais une
fonction politique officielle. Mais il est propulsé dans
les jeux politiques du parti au pire moment, car presque aussitôt,
Thorez est frappé d'hémorragie cérébrale.
Son départ en URSS où il se fait soigner pendant presque
trois ans prive Aragon du principal soutien qu'il a dans le parti.
Critiqué pour la ligne d'ouverture qu'il avait incarnée,
il est dans une situation politique délicate à l'heure
des crispations et du repli sur l'ouvriérisme. Au début
de 1953, la fin de Ce soir et la reprise des Lettres Françaises
pourraient être le signe d'une certaine distanciation politique.
Mais c'est juste à ce moment qu'éclate la crise interne,
à l'occasion de la publication par les Lettres Françaises,
en mars 1953, d'un hommage à Staline qui vient de mourir
: son portrait en « une » par Picasso est considéré
de l'intérieur comme un véritable scandale. Picasso
a dessiné un Staline jeune aux traits durs, loin de l'image
du « Père des peuples ». Directement visé
par un communiqué public du secrétariat, Aragon se
livre alors à une autocritique, publique elle-aussi.
Il faut être Pierre Daix, et avoir travaillé quinze
ans avec Aragon pour pouvoir dire que l'affaire du portrait touche
le lien affectif noué avec le parti. Elle révèle
en tout cas après-coup le sens des gages accumulés
auparavant pour prouver qu'Aragon avait choisi son camp. Car pendant
les années de Guerre Froide, c'est en multipliant les signes
publiques de rupture avec le champ littéraire qu'il a manifesté
son appartenance au PC. On peut penser, en effet, ce qu'on veut
de l'éloge de Jdanov de septembre 1948, il peut être
lu comme une position politique cohérente avec son engagement.
Même la défense des thèses de Lyssenko et de
la science prolétarienne dont celui-ci est le porte-parole,
peut se comprendre, pour surprenante qu'elle soit, comme l'acte
politique d'un croyant. Mais le sommet dans la rupture, ce sont
les Communistes. Le roman, dont la publication commence en 1949
pour s'interrompre en 1952, est la faute suprême selon les
règles du champ littéraire. Prendre pour sujet, en
pleine Guerre Froide, la période douteuse d'après
le Pacte germano-soviétique qu'il faudrait justement s'efforcer
d'oublier, c'est profaner le roman pour en faire l'instrument du
débat politique. Et y peindre Nizan et sa femme sous les
traits d'un couple abject de traîtres, c'est se peindre soi-même
comme celui qui méprise le jugement de ses pairs.
Il y a en effet un instinct suicidaire
chez celui qui, sans être l'auteur de la « liste noire
» de l'épuration littéraire, s'en fait pourtant
l'exécuteur principal au point d'en devenir l'auteur dans
les mémoires. De même, reprendre à son compte,
en littérature, les calomnies contre Nizan lancée
par Thorez et dénoncées par Sartre, c'est pratiquer
une forme de « persiste et signe » qui s'apparente à
de l'auto-mutilation et qui n'est pas sans rappeler la période
surréaliste. On a le droit de s'étonner et de trouver
curieuses les règles du champ littéraire. Il n'en
reste pas moins que de toutes les marques accumulées d'appartenance
politique, les Communistes sont celles qui portent le plus loin.
Au point de s'obliger, par la suite, à faire ce geste unique
dans l'histoire littéraire : réécrire totalement
le roman.
En 1953, Aragon n'en est pas là.
Apportant sa contribution au culte de la personnalité, il
salue le retour de Thorez par un poème donné à
l'Humanité. « Il revient » est aussi l'expression
d'un soulagement puisque c'en est fini de la crise interne au parti
qui l'a profondément marquée. Mais une page est tournée.
Les poèmes des Yeux et la mémoire (Gallimard, 1954)
où le parti est encore présent comme celui que l'on
sert, marque une première étape d'un retour sur soi.
Ils préparent le Roman inachevé (Gallimard, 1956).
Avant 1953, Aragon coupait les ponts. Après cette date, il
commence au contraire à tendre des perches. La préface
qu'Etiemble donnera en 1966 au Roman inachevé, dix ans après
la première édition, montrera qu'elles auront été
saisies. Mais avant qu'on puisse ainsi célébrer le
« retour » d'Aragon, il aura fallu faire un grand numéro
d'équilibriste.
![]()